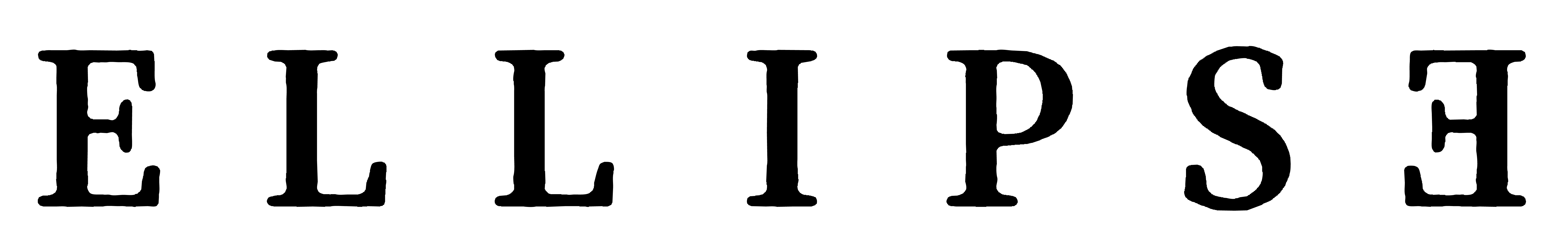Emerveillement de Kathy Page
Nicole Laurendeau
Traduction
Émerveillement
Moi, April, le bébé de la famille, appelée parfois « Ape », je connaissais à peine ma sœur aînée Julia, et même si j’essayais de toutes mes forces d’aimer Hazel, elle ne faisait pas attention à moi et ne s’intéressait qu’aux oiseaux. Elle gagnait des prix pour ses croquis, chaque oiseau dessiné d’un contour ferme, la tête pointée vers la gauche, puis coloré à l’aquarelle. Au bas, elle inscrivait les noms, commun et scientifique, de même que la saison et le symbole pour mâle ou femelle, et elle signait son nom, Hazel Seymour. Quand elle fixait par des punaises ses croquis aux murs de sa chambre et créait ainsi une mosaïque aussi surpeuplée qu’une plage en été, ma mère ne la punissait pas pour avoir abîmé les murs, mais moi, elle m’avait disputée pour avoir ri quand Hazel s’était coincé la tête dans le garde-fou pour observer les canards mandarins au parc Palmerston. Les pompiers avaient dû venir la libérer.
Hazel était mince, délicate, avec des joues rouges et des yeux bruns petits mais pétillants. Quand elle ne parlait pas des oiseaux, elle demeurait silencieuse ou l’air absent. Elle restait assise des heures au jardin, immobile sous un tas de chandails, son guide d’identification, un carnet et un crayon à portée de main. Parfois elle y notait un bruant jaune ou un bouvreuil, mais la plupart du temps, elle ne dessinait que des oiseaux communs comme le pinson ou le merle, à tous les âges et à toutes les étapes. Son oreille affinée à leurs appels filtrait nos voix.
Elle se disputait toujours avec ma mère à propos de rentrer pour le dîner ou le souper plutôt que de grignoter à la sauvette. Elle me faisait sentir terriblement coupable de manger du poulet ou d’avoir toujours faim. Elle amassait son argent de poche pour s’acheter des jumelles. Quand elle serait grande, elle serait ornithologue.
Hazel adorait les oiseaux et moi, impuissante à l’atteindre mais incapable d’y renoncer, j’épiais sa passion. J’ai compris que l’amour ne se donnait pas à moitié. Et qu’il n’était ni rationnel, ni juste. Il exigeait une totale dévotion, tout comme son opposé, la haine. Notre mère haïssait les microbes et passait ses journées à les combattre. On devait les tenir loin de notre bouche ou de notre nez, et ne jamais se toucher à ces endroits, mais au cas où on l’aurait oublié, il fallait vite se laver les mains avec le savon ambré transparent pour les exterminer. Les microbes sortaient de notre derrière et se faufilaient dans le papier quand on s’essuyait. On était toutes constamment constipées. Les microbes se cachaient dans le gazon, alors il fallait toujours porter des chaussures dehors. Près des marches arrière se trouvaient un petit bol de désinfectant laiteux et une brosse à récurer pour nettoyer nos semelles. Mes parents adoraient jardiner et maman enfilait des gants pour la moindre tâche extérieure, puis elle les rinçait et les laissait sécher dehors. On devait faire la même chose, mais on oubliait.
Tout objet qui entrait dans la maison devait être lavé sur-le-champ, même ceux scellés de plastique. Chaque jour, maman frottait toute la cuisine avec un javellisant, même les murs. Les animaux étaient les pires porteurs de microbes car ils se fourraient le nez partout alors évidemment, aucun d’eux ne pouvait entrer. Chez nous, tout ce qu’on touchait était presque toujours humide du coup de chiffon juste reçu.
J’étais rêveuse. Hazel était intelligente et très bonne à l’école. Elle m’a appris que les microbes étaient aussi ce qui causait les bébés. Ils venaient de l’homme et entraient dans la femme si elle ne faisait pas attention. Et puis, avait-elle ajouté, j’étais un accident, ce que j’ai compris comme un échec en matière de propreté. Elle avait toujours les meilleures notes. M. Leaper avait dit à ma mère qu’elle était une scientifique-née et qu’elle pourrait facilement entrer à l’université. Tout le monde l’y a encouragée.
Papa avait travaillé pendant des années à une mangeoire à oiseaux à l’épreuve des chats pour Hazel, mais il ne l’a jamais finie. Ça lui arrivait souvent, et la remise était pleine de projets abandonnés, mais dans ce cas, c’était peut-être parce qu’en son for intérieur, il se disait que les bêtes devaient être laissées à leur place — sur une ferme ou dans notre assiette — et parce qu’il adorait le jardin et détestait les pigeons, qui viendraient peut-être à la mangeoire s’il la finissait — et puis les chats et les chiens. Une passion en requiert ou en altère une autre. Il a couvert les framboises et les petits pois d’un fin filet vert, et il a tenu les chiens à l’écart par une haute clôture et du fil barbelé tissé à travers la haie. Mais on ne pouvait rien contre les chats sauf les pourchasser.
Hazel n’aimait pas non plus les chats, mais elle détestait encore plus le tapage de nos poursuites. Pendant les repas, elle gardait son carnet près de son assiette. Elle s’étirait le cou et gardait les yeux rivés sur ce qu’elle pouvait voir du jardin, et moi je la regardais compter et noter, chipoter sa nourriture, une bouchée par-ci, une bouchée par-là. Je me suis mise à penser que quand elle serait grande, elle ne serait pas ornithologue mais se transformerait en oiseau. Je voulais qu’elle s’envole. J’étais jalouse, une autre chose qui ne peut se faire à moitié.
Le pic vert est un oiseau étonnant avec ses yeux masqués et sa tache rouge sur la tête, comme une calotte. Il tremblait et avait l’aile cassée, et Hazel l’avait trouvé dans la haie, l’avait enveloppé dans son lainage et l’avait ramené à la maison. Elle le voulait à l’intérieur. Je me tenais près de ma mère sur le seuil, attendant de voir ce qui allait se passer. Le visage de maman était sévère, les lèvres pincées, le souffle retenu pour ne pas aspirer l’air contaminé. Elle s’est longuement essuyé les mains sur son tablier. Moi, j’épiais les yeux sombres de Hazel qui cherchaient le regard gris pâle de ma mère et s’en emparaient, mi-suppliants, mi-impérieux.
« Picus Viridus, a-t-elle annoncé, je le veux dans ma chambre. » Puis elle a ajouté : « Je peux le soigner. Une expérience scientifique. » Les mains de ma mère se sont immobilisées. Aucune de nous ne respirait.
« Je suppose que ça ira, a-t-elle répondu, si tu l’essuies bien. »
Comme ma mère aimait Hazel – encore plus qu’elle ne haïssait les microbes! J’ai regardé ma sœur essuyer doucement le pic vert avec le désinfectant, puis le monter dans sa chambre.
Peu après, j’ai gagné deux poissons rouges dans une foire et je les ai apportés à la maison dans un sachet de plastique, le cœur dilaté, l’estomac à l’envers et fragile comme le sac. C’était, je le savais, un genre de test. Mais debout sur les tuiles de l’entrée, j’ai senti mes yeux se détourner de ceux de ma mère et non tenter de les envoûter comme Hazel l’avait fait. Les poissons ne sont pas des animaux, ai-je insisté et puis, c’était seulement juste. Je voulais garder mes poissons dans un aquarium dans ma chambre, comme ma sœur avec son pic vert. Mais, a fermement répondu ma mère, ce n’était pas la même chose. Ces poissons n’étaient pas malades, et personne ne disait que j’étais une scientifique-née. Et puis, c’était difficile de voir comment les essuyer.
« Je vais demander à ton père si tu peux les garder dans le jardin », a-t-elle décidé.
Sous l’arbre à feuilles rouges que mon père appelait Prunus, un aquarium a été armé de fil de fer qui passait au-dessus et descendait sur les côtés, avant d’être niché sous de vieilles briques. C’était pour arrêter les chats, et les renards. Les renards venaient la nuit. On les entendait glapir entre eux et on les voyait parfois trotter sur le sentier les soirs de lune. Quelquefois, je rêvais aux renards, à leurs coups de pattes et de museau dans les briques qui retenaient le maillage à l’aquarium. Je rêvais que je trouvais l’aquarium vide et deux squelettes blancs, léchés tout propres, sur le vert vif du gazon. J’aimais mes poissons. Je ne les dessinais pas. Je les regardais, c’est tout.
[…]
J’ai continué à aller voir mes poissons au jardin chaque jour. Je me couchais sur le ventre et je les regardais ondoyer entre les herbes, aspirer leur nourriture à la surface ou simplement rester suspendus dans un genre de sommeil de poisson. Le temps s’étirait et se contractait et passait. Dans ma chambre, des animaux de peluche s’alignaient sur mon lit. Un ours panda, un hibou, un kangourou, un lion, les yeux en bouton. Je les aimais presque mais je voyais bien la différence entre le vivant et le bourré, entre l’émerveillement et le réconfort. Entre humains et animaux, animaux et oiseaux, entre oiseaux et poissons qui eux, vivaient là où les humains ne pouvaient même pas respirer. Il n’y avait que le verre pour les séparer d’un monde empoisonné. C’était peut-être cruel de les garder, mais je ne pouvais plus imaginer la vie sans l’or fluide de leur mouvement ou le regard soudain de leurs yeux pivotants. Les observer, c’était un peu découvrir une partie intérieure de moi, secrète et miraculeuse. Ça doit, je me disais, être la même chose pour Hazel et ses oiseaux. Je lui ai pardonné. Je me suis dit que si ce qu’elle avait raconté à propos de l’accident des microbes dans ma mère était vrai, alors elle aussi, elle en était un.
Cet hiver-là, il a neigé et, une nuit, mon aquarium s’est pétrifié en solide bloc de glace blanche. Tous les jours, je me frayais avec peine un chemin dans la neige pour venir le voir, un peu comme les gens visitent les cimetières. Muette de reproche, j’ai refusé qu’on le jette aux ordures. Au dégel, j’ai regardé la glace fondre jour après jour pour enfin révéler une faible lueur dorée tout au centre. J’étais de plus en plus triste, comme si moi aussi, je fondais. Et puis, alors que j’étais là, les deux poissons ont bougé, très lentement, comme s’ils s’éveillaient d’un long rêve glacé.
Commentaire
L’étonnante Kathy Page nous fait découvrir le monde intérieur d’une fillette qui vit dans l’ombre de sa sœur. Invisible sans le nommer, elle passe inaperçue aux yeux de sa famille qui nourrit en elle cette impression d’être inexistante : on ne l’entend pas, on la voit à peine, on lui fait comprendre que ce qu’elle désire n’a pas vraiment d’importance.
Contrairement à la jeune April qui subit cette invisibilité sans la vouloir, la traductrice la recherche, en fait son but ultime. Se perdre dans les mots qui ont surgi du puits créatif de l’écrivaine, retrouver le battement du cœur, le rythme des pensées, la ligne fragile d’émotions, c’est la quête ultime de celle qui se donne pour mission de devenir la voix de l’autre, de porter son souffle, sa musicalité, de n’être que le conduit de la magie du texte. Une invisibilité qui, si elle est réussie, constitue l’essence de l’art de la traduction et porte sa récompense en soi.
Quelques communications avec l’autrice se sont avérées nécessaires pour clarifier soit un mot, soit un segment riche de sens. Malgré un ordre du jour particulièrement chargé, l’écrivaine a su répondre avec beaucoup de générosité et a compris l’importance pour la traductrice de bien saisir le sens profond de chaque image, afin de livrer un texte d’une transparence aussi pure que possible, qui laisse passer sans obstacle la lumière de l’intention première. Ce voyage guidé par Kathy Page m’a permis de découvrir non seulement une artiste remarquable, mais une femme exceptionnelle qui sait être à l’écoute et qui fait preuve de beaucoup de respect envers le travail des artisans de la traduction.
Texte original tiré de The House on Manor Close (nouvelle)
I, the baby, April, sometimes known as “Ape,” hardly knew my eldest sister, Julia, and although I desperately wanted to love Hazel, she ignored me and cared only for birds. She won prizes for her bird drawings, which she did in a firm outline, head pointing to the left, and then filled in with watercolour. Beneath, she printed the common and proper names, the season, and a sign for male or female, and signed her name, Hazel Seymour. When she used drawing pins to display these drawings on the walls of her room, turning them into a vista as over-populated as a summer beach, my mother did not punish her for ruining the walls, though she scolded me for laughing at Hazel when she stuck her head between the railings of Palmerston Park to watch the mandarin ducks. The fire brigade had to come and saw her free.
Hazel was thin, fine-boned, with red cheeks and small but glistening brown eyes. When she wasn’t talking about birds, she was silent, or absent. She sat for hours in the garden, motionless and bundled in sweaters, her field guide, notebook and pencil at the ready. Occasionally there was a yellowhammer or a bullfinch, though mostly she just noted common birds like chaffinches and robins, in all their ages and stages. Her ears, tuned to their calls, filtered out our voices.
She argued constantly with my mother over coming in for dinner or lunch, and not eating when she did. She made me feel terrible for eating chicken and always being hungry. She was saving her pocket money for binoculars. When she grew up she would be an ornithologist.
Hazel loved birds and I, unable to break through, but unwilling to give up, observed this passion of hers. I saw that love could not be done by halves. Nor was it rational, or fair. It demanded dedication, as did its opposite, hate. Our mother hated germs and fought them daylong. They had to be prevented from getting in our mouths or noses and the important thing was not to touch either of these places, but in case we forgot, we had to wash our hands with amber-coloured see-through soap to kill them. Germs came out of your bottom and crept through the paper as you wiped yourself. All of us were chronically constipated. Germs were in the grass, so we always wore shoes outdoors. By the back step stood a little bowl of milky disinfectant and a scrubbing brush for us to clean the soles. My parents shared a passion for the garden, and Mum donned gardening gloves for the simplest outdoor task, then afterwards rinsed them and left them to dry outside. The rest of us were supposed to do the same, but forgot.
Anything new that came indoors was washed straight away, even if it was sealed in plastic. Daily Mum scoured the kitchen with bleach, including the walls. Animals were prime carriers of germs, due to sniffing themselves, and so naturally none were allowed in. In our house, things you touched were nearly always damp from just having been wiped.
I was dreamy. Hazel was clever and did very well at school. I learned from her that germs were also what made you have a baby. They came from the man and got in the woman if she wasn’t careful. Also, she said, I was an accident, by which I understood some failure on the cleaning front. She always got top marks. Mr. Leaper told my mother she was a born scientist and could easily go to university. Everyone encouraged her.
Dad was for years designing Hazel a cat-proof bird table, though he never completed it. He often didn’t finish things, and the shed was full of abandoned projects, but perhaps in this case it was also because in his heart he felt creatures should be kept in their place—which was the farmyard or on the dinner plate—and because he loved the garden and hated both pigeons, which might use the bird table if he actually finished it—and cats and dogs. One passion necessitates or modifies another. He covered the raspberries and peas in fine green net, and the garden was kept dog-proof by tall fences and barbed wire threaded through the hedges. But there was nothing you could do about cats except chase them.
Hazel disliked cats too, but hated even more the disturbance caused by chasing them. At mealtimes, she kept her notepad by her plate. She craned her neck and fixed her eyes on what she could see of the garden, and I in turn watched her as she counted and marked, occasionally picking at her food, a morsel here, a morsel there. I began to think that when she grew up she would become not an ornithologist but an actual bird. I wanted her to fly away. I was jealous, something else that can’t be done by halves.
The green woodpecker was an astonishing bird, with ringed eyes and a red patch on its head, like a skullcap. It was shivering and had a broken wing and Hazel had found it in a hedge, wrapped it in her cardigan and carried it home. She wanted to bring it in. I stood beside my mother on the threshold, and waited to see what would happen. Mum’s face was tight, her lips sealed, her breath held against the germ-laden air. She wiped her hands up and down on her apron. I watched as Hazel’s dark eyes sought my mother’s pale grey ones and tugged at them, half pleading, half imperious.
“Picus Viridus,” she announced, “I want to keep it in my room—” adding, “I can make it better. A scientific experiment.” My mother’s hands fell still. None of us breathed.
“I suppose so,” she replied, “if you wipe it down.”
How very much my mother loved Hazel—even more than she hated germs! I watched my sister wipe the green woodpecker gently with disinfectant, and then carry it up to her room.
Shortly after this, I won two goldfish in a fair and brought them home in a plastic bag, my heart swollen, my stomach brimful and fragile like the bag. It was, I knew, some kind of test. But as I stood on the tiled doorstep, I felt my eyes sliding away from my mother’s, even as I tried to magic her the way Hazel had. Fish were not animals, I insisted and besides, it was only fair. I wanted to have the fish in a tank in my bedroom, like my sister and her green woodpecker. But, Mum insisted in return, it was not the same. The fish were not sick, and no one said I was a born scientist. Also, it was difficult to see how to wipe them.
“I’ll ask your father if you can keep them in the garden,” she decided.
Underneath the red-leaved tree my father called Prunus a tank was covered with wire that went right over the top and down the sides and was then tucked in under some old bricks. This was to stop cats, and foxes. The foxes came at night. You heard them shriek to each other and you might catch sight of them trotting up the path if the moon was out. Sometimes I dreamed of the foxes, pawing and nosing at the bricks that held the mesh on the tank in place. I dreamed of finding an empty tank and two white skeletons, sucked clean, on the bright green lawn. I loved my fish. I didn’t draw them. I just looked.
[…]
I still went to see my fish in the garden every day. I lay on my stomach and stared at them as they wove between the weeds, sucked their food from the water’s skin or simply hung suspended in a kind of fishy sleep. Time stretched and shrunk and passed. Inside, in a row on my bed, I had animal toys. A panda bear, an owl, a kangaroo, a lion, all with button eyes. I almost loved them but I knew there was a difference between the living and the stuffed, between wonder and comfort. Between humans and animals, animals and birds, between birds and fish, which lived where people couldn’t even breathe. They had only glass to hold them from a poisonous world. Maybe it was cruel to keep them, but now I could not be without their swimming gold and their sudden, swivelling eyes. Looking at them was somehow looking inside me, at a part I didn’t understand, a secret and a miracle. It must, I thought, be the same for Hazel with her birds. I forgave her. I reasoned that if she was right about my mother’s accident with the germs, then she was one as well.
That winter, it snowed and my fish tank froze overnight to a solid block of white ice. I trudged through the snow to visit it every day, as people visit graves. Dumb with reproach, I refused to allow it to be disposed of. When the thaw came, I watched the ice melt day by day, revealing a small golden glow at the very heart. I felt sadder and sadder, as if I was melting too. And then, as I watched, the two fish moved, slowly at first, as if waking from a long, cold dream.
commentary
Kathy Page, an amazing story teller, enters with us the inner world of a young girl who lives in the shadow of her older sister. Invisible without ever naming it, she goes by unnoticed by her family who feeds within her the impression of being inexistant: she is not heard, remains almost unseen, she’s being reminded that her desires bear no weight.
In contrast with the young April who suffers from this invisibility, the translator longs for it, makes it her ultimate goal, in fact. To dive into the words emerged from the writer’s creative well, to find the heartbeat, the rhythm of thoughts, the elusive underworld of emotions, is the ultimate quest as she gives herself the mission of becoming the voice of the other, of carrying the writer’s breath, her musicality, of becoming the channel for the magic of her words. This invisibility, if successful, sums up the art of translation and bears in itself its own reward.
A few communications with the author have been necessary in order to clarify a word or a segment rich in potential meanings. In spite of a very busy agenda, the writer has responded with much generosity and showed she understood how important it is for the translator to capture the deep sense hidden in every image, in her desire to deliver a text that will be as transparent as possible, that will allow the light of original intent to shine through without obstacle. This journey guided by Kathy Page has made me discover not only a remarkable artist, but also an exceptional woman who knows to listen and who shows great respect for the work of the translation craftsperson.