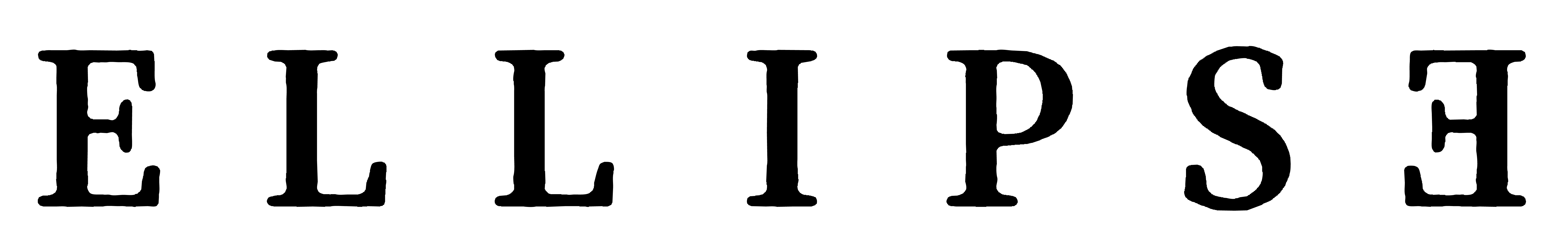Capital coolinaire by Nora Bouazzouni
Clare Thorbes
There’s no such thing as male or female taste[1], and no rich or poor person’s taste, either (though I’m sure the rich have a taste for extra helpings). What we call “tastes”—meaning our preferences and more generally our cultural practices—aren’t limited by income alone; they’re the product of shifting social norms that are learned or handed down early in life, which helps us distinguish between “us” and “them”. To put it bluntly, going to the opera on a regular basis, listening to France Culture, playing tennis and swooning over egg and truffle brouillade isn’t exactly proletarian fare (I’ll get into the finer details once I’ve laid the groundwork).
Other people’s tastes
In La Distinction, sociologist Pierre Bourdieu writes: “Taste is the foundation of all that we have, whether people or things, and of all that we are to others, of how we rank ourselves and how others rank us. Taste is the practical assertion of an inevitable difference.[2]” His argument is based on two concepts. The first is habitus: tastes are assimilated early and are the fruit of social conditioning, the handing down of cultural capital, and the reflection of our place of origin. The second is cultural legitimacy, a symbolic class struggle in which those at the top of the food chain distinguish themselves by rejecting the tastes of the working class to reinforce their hegemony. “The rules of taste and cultural practices are fundamentally involved in reproducing dominance relationships through the imposition of a cultural arbiter who shares the culture of the ruling class.[3]” As the saying goes, all tastes are natural, but not all tastes are equal. And who decides? The rich. Well, not all of them, because being rich isn’t just about money; it’s about codes. For example, a poor person who wins the lotto and becomes a multimillionaire isn’t considered legitimate among the ruling classes. It would take several generations and the accumulation of cultural, social, and educational capital, in addition to financial capital, for that person’s children or grandchildren to become “real” rich people. The Olivier Baroux films featuring the blue-collar Tuche family, whose unemployed patriarch wins 100 million euros in the lottery, perfectly illustrates this class violence. Whether they settle in Monaco or the United States or at the Elysée Palace, the Tuches are still considered to be proletarians and rednecks. They have a strong Northern accent, eat potatoes every which way, dress in flashy colours, and aren’t in the intellectual professions. They ask the chef at the Elysée Palace for samurai sauce, prefer Tahiti shower gel to Chanel products, drink champagne with a straw, talk loudly, and declare that “work sucks.” In short, whether they’re in luxury hotels or at the Monaco country club, ride in a sports car or a Renault Nevada, the Tuches don’t know the codes of the ruling class and that prevents them from fitting into their new environment. “We landed on a different planet, but we were the aliens,” says their son, a genius and future class renegade.
Soccer stars too, by virtue of their sport (tennis players enjoy far higher social status) and their origins, “are not rich; they’re poor people with money,” says Denis Colombi. In other words, they “continue to be identified as representatives of the working class, even though they obviously have the financial means to distance themselves from it[4]. That’s probably why the cultural elite is more disturbed by Franck Ribéry eating a gold-covered, 287-euro rib steak in Dubai than by the food habits of Bernard Arnault or Francois Pinault. Never mind that 80% of French billionaires, so quick to invoke the work ethic and a pseudo-meritocracy, inherited their fortune. “The players’ sin isn’t that they have money; it’s that they don’t have the knowledge or ability to fit into the world of the rich, the world of those who legitimize economic wealth through cultural and symbolic wealth.[5]” Ribéry’s offence wasn’t that he ate a slab of overpriced gilded meat; it’s that he wasn’t entitled to eat it. The image of “pearls before swine” puts the parvenus in their place: since the idea of a naturally and objectively superior taste (the proverbial “good taste”) is accepted as universal truth instead of a symbolic tool of domination, certain groups would be naturally incapable of appreciating the true value of a given cultural icon (dining at a Michelin-starred restaurant, premium champagne, an art masterpiece, a luxury watch, the ballet, an arthouse film, etc.). The value could be economic, aesthetic, social, or all of the above. Beyond personal preference or the intrinsic qualities of an item, its value as a symbol is what creates acceptance and allows a person to “symbolically join the group, the social rank, or the culture of reference, and to move from the periphery to the centre or from the bottom to the top of the social hierarchy.[6]” The brilliant documentary Sour Grapes[7] recounts how in the 2000s, after the Internet bubble burst, auction houses bet heavily on French grand crus. At the time, a small, exclusive circle of ultrarich wine lovers were arguing over six-figure bottles when an unknown young Indonesian with a discerning palate arrived on the scene. Rudy Kumiawan took part in their wine tastings, won their trust and sold them burgundy at premium prices—counterfeits that the so-called wine aficionados were unable to detect. The part where they find out is delicious, because their credibility evaporates along with their money. We get a close-up view of their disintegrating status. One of them, staring into the camera and obviously in shock, refuses to believe that he’s been duped. He tasted the wines, they can’t be plonk! But it wasn’t his palate that betrayed him; it was “good taste”, a system of subjective values imposed by his class and from which he benefitted—the “socially accepted ability to make choices in accordance with an implicit norm that is itself socially defined.[8]”
“Good taste” is legitimized by social status and vice-versa, but it’s an arbitrary hierarchy. For example, caviar, truffles and lobster weren’t always luxury foods. Until the Middle Ages, Europeans used to feed sturgeon eggs to the pigs[9]. The Russian elites who emigrated to Europe in the early 20th century gave caviar its cachet. The result: the rich went mad for it, then there was overfishing and poaching, then the supply dwindled, then the price went up, and then its scarcity lent it prestige. The same thing happened with lobster. Its abundance in the Atlantic Ocean along the North American coast made the crustacean a humdrum product that was even served to prisoners and used as fertilizer. It became a hot commodity at the end of the 19th century with the development of the railroad, introduced as an exotic dish on trains linking the east and west coasts. Passengers drove up demand, then came overfishing and scarcity. Social prestige + scarcity = high price = luxury = social prestige. Truffles, like all mushrooms, were once disparaged in France, but they climbed the social ladder in the 18th century. Dairy products were the preserve of the lower classes until the 18th century, and cheese wasn’t a gourmet item until the Second Empire[10]. Vegetables changed status several times over the course of history, while meat, long reserved for the nobility, only became available to the masses in the mid-19th century. The French culinary canon is based on bourgeois cuisine, which in turn sought to imitate the nobility. But as Madeleine Ferrières says, “what we consider to be fine bourgeois cuisine actually has its roots in the food of the poor.” Because they’re a social construct, “tastes change: some popular dishes become refined, while others disappear from menus and cuisines.[11]” Even the Western triptych of appetizer-main-dessert, a creation of gourmet restaurants, has only been around since the 19th century. In light of this, any talk of “French culinary tradition” borders on historical nonsense. When was the tradition launched? Where? For which demographic? In continental France, the invention of “gastronomy” after the Revolution established the tradition’s authenticity. That’s a short history in a land that’s been inhabited for 1.8 million years. In fact, historian and sociologist Alain Drouard [12] says it’s a myth, “an imaginary tale crafted from a set of collective beliefs and perceptions about French cuisine, its excellence and its age-old supremacy over other national cuisines.” The myth came out of the “French cuisine system,” that is, “a set of interdependent relationships among three main players: food critics, chefs and connoisseurs of good food.” The aristocracy, which is the arbiter of the “good taste” inherited from the Court and the generator of social standards, codified this with books on gastronomy “that assert the identity of French cuisine, defined as aristocratic and bourgeois cuisine, and declare its dominion over foreign cuisines.” These books, followed in the 19th century by the first restaurant guides (like Grimod de la Reynière’s Almanach des Gourmands), were primarily educational tools aimed at the new ruling class, the bourgeois and the nouveau riche, for whom the mastery of good taste was an instrument of power, distinction and social acceptance. In his seminal best-seller, The Physiology of Taste (1825), Brillat-Savarin not only set out precepts for the ruling classes (including his famous quotation “you are what you eat”); he also enshrined gastronomy as gastro-policy, even gastro-diplomacy, which “makes a powerful contribution to the strength and prosperity of empires.” By disseminating French food ideology, the elites “establish people of taste as connoisseurs and gourmets.[13]” In other words: good people eat well.
1. This is a shameless self-promo for my previous book, Steaksisme – En finir avec le mythe de la végé et du viandard (Nouriturfu, 2021).
2. La Distinction, Pierre Bourdieu (Les Éditions de Minuit, 1979)
3. Op. cit.
4. Où va l’argent des pauvres, op. cit.
5. Ibid.
6. Claude Fischler, L’Homnivore (Odile Jacob, 1990).
7. Produced by Jerry Rothwell (United Kingdom, 2016). My favourite documentaries are ones in which the haves are tripped up by their own strategies for setting themselves apart and accumulating capital: fake paintings, fake jewellery, fake festivals, etc.
8. L’Homnivore, op. cit.
9. Christian Millau, Dictionnaire amoureux de la gastronomie (Plon, 2008).
10. Madeleine Ferrières, Nourritures canailles (Seuil, 2007).
11. Op. cit.
12. Alain Drouard, Le mythe gastronomique français (CNRS Éditions, 2010).
13. Op. cit.
Capital coolinaire
par Nora Bouazzouni
Un extrait de Mangez les riches : La lutte des classes passe par l’assiette
© Nouriturfu, 2023
Tout comme il n’y a pas de goût masculin ni de goût féminin[1], il n’existe pas plus un goût de riche qu’un goût de pauvre (quoique, je suis sûre que les riches ont un goût de reviens-y). Ce qu’on appelle « goûts » – c’est-à-dire nos préférences et, plus largement, nos pratiques culturelles – ne sont pas circonscrits par le seul revenu, mais sont le produit de normes sociales mouvantes, très tôt apprises ou transmises, qui permettent d’identifier les nôtres et les autres. Grossièrement, se rendre régulièrement à l’opéra, écouter France Culture, faire du tennis et adorer la brouillade d’œufs aux truffes ne sont pas exactement des trucs de prolétaires (je serai plus nuancé une fois qu’on aura débroussaillé le terrain).
Let goûts des autres
Dans La Distinction, le sociologue Pierre Bourdieu écrit: « Le goût est le principe de tout ce que l’on a, personnes et choses, et de tout ce que l’on est pour les autres, de ce par quoi on se classe et par quoi on est classé. Les goûts sont l’affirmation pratique d’une différence inévitable[2]. » Sa thèse repose sur deux concepts. Premièrement, l’habitus : les goûts, incorporés très tôt, sont le fruit d’un conditionnement social, la transmission d’un capital culturel et le reflet de notre milieu d’origine. Deuxièmement, la légitimité culturelle, une lutte des classes symbolique où les dominants.es se distinguent en rejetant les goûts des classes laborieuses, afin de renforcer leur hégémonie : « Les systèmes de goût et les pratiques culturelles participent fondamentalement à la reproduction des rapports de domination par l’imposition d’un arbitraire culturel, qui correspond à la culture des classes dominantes[3]. » Comme dit l’adage, tous les goûts sont dans la nature, sauf que tous les goûts ne se valent pas. Et qui décide ? Les riches. Enfin, pas tous, car être riche ce n’est pas qu’une question d’argent, c’est une question de codes. Par exemple, un pauvre devenu multimillionnaire grâce au Loto n’est pas considéré comme légitime parmi les classes dominantes. Il faudra plusieurs générations, et l’accumulation d’un capital culturel, social, scolaire, en plus du capital financier, pour que ses enfants ou ses petits-enfants soient de « vrais » riches. Les films d’Olivier Baroux mettant en scène les Tuche, dont le patriarche au chômage gagne 100 millions d’euros à la loterie, illustrent parfaitement cette violence de classe. Qu’ils s’installent à Monaco, aux États-Unis ou à l’Élysée, les Tuche sont toujours considérés comme des prolétaires, des beaufs. Ils ont un fort accent du Nord, se nourrissent de patate sous toutes ses formes, s’habillent avec des couleurs flashy, n’exercent pas de profession intellectuelle, demandent de la sauce samouraï au chef cuisinier de l’Élysée, préfèrent le Tahiti douche au produits Chanel, boivent le champagne à la paille, parlent fort, clament que « travailler, c’est nul »… Bref, dans les hôtels de luxe comme au country club monégasque, en voiture de sport comment en Renault Nevada, les Tuche n’ont pas les codes des classes dominantes et ça les empêche de s’intégrer à leur nouvel environnement. « On débarquait sur une autre planète, sauf qu’ici, c’étaient nous les extraterrestres », raconte leur fils, surdoué et futur transfuge de classe.
Les footballeurs stars eux aussi, par le sport qu’ils pratiquent (les tennismen ont autrement plus de prestige social) et leur extraction, « ne sont pas riches : ils sont plutôt des pauvres qui ont de l’argent », écrit Denis Colombi. C’est-à-dire qu’ils « restent identifiés comme des représentants des classes populaires bien qu’ils disposent, évidemment, de ressources économiques qui les en éloignent[4] ». C’est sans doute pour cette raison que l’élite culturelle s’émeut davantage d’un Franck Ribéry mangeant une entrecôte recouverte d’or à Dubaï (287 euros) que des habitudes gastronomiques des Bernard Arnault et François Pinault. Peu importe que 80 % des milliardaires français, si prompts à invoquer la valeur travail et la pseudo-méritocratie, aient hérite de leur fortune : « La faute de joueurs n’est pas tant d’avoir de l’argent que de ne pas savoir et de ne pas pouvoir intégrer le monde des riches, de ceux qui légitiment la richesse économique par la fortune culturelle et symbolique[5]. » Ce qui est reproché à Ribéry, ce n’est pas de manger un morceau de viande doré hors de prix, mais de ne pas être légitime à le manger. C’est l’image de « la confiture aux cochons » qui permet de remettre les parvenus à leur place : puisque l’idée d’un goût naturellement et objectivement supérieur (le fameux « bon goût ») est admise comme une vérité universelle et non comme l’instrument symbolique d’une domination, certaines populations seraient naturellement incapables d’apprécier à sa juste valeur tel objet culturel (dîner étoilé, champagne haut-de-gamme, tableau de maître, montre de luxe, ballet, film d’auteur…). Valeur qui peut être économique, esthétique, sociale ou bien tout ça à la fois. Au-delà des préférences personnelles out des qualités intrinsèques d’un objet, c’est sa valeur en tant que signe qui suscite l’adhésion et permet « de s’intégrer symboliquement au groupe, à la catégorie sociale, à la culture de référence, de se rapprocher individuellement de la « périphérie » vers le « centre » ou du bas vers le haut de la hiérarchie sociale[6]» Le génial documentaire Sour Grapes[7] raconte comment dans les années 2000, après l’éclatement de la bulle Internet, les sociétés de vente aux enchères ont mis le paquet sur les grand crus français. Le petit cercle très fermé des richissimes amateurs de vin se dispute alors des bouteilles à six chiffres quand débarque Rudy Kumiawan, jeune Indonésien inconnu au bataillon, mais au palais averti. Celui-ci participe à leurs dégustations, gagne leur confiance et leur vend du bourgogne à prix d’or. Des contrefaçons. Que ces soi-disant passionnés de vin sont incapables de détecter. La séquence où ils apprennent est jouissive, car en plus de leur argent, c’est leur crédibilité qui s’évapore. On vit leur désintégration statutaire en direct. Face caméra, l’un d’eux, sous le choc, refuse de croire qu’il s’est fait berner : ces vins, il les a goûtés, ça ne peut pas être de la piquette ! Or, ce n’est pas son palais qui l’a trahi, mais le « bon goût » en tant que système de valeurs subjectives imposé par sa classe et dont lui-même bénéficiait – cette « capacité socialement reconnue de procéder à des choix conformes à une norme implicite elle-même socialement définie[8]»
Le « bon goût » est donc légitime par le statut social – et inversement – alors qu’il s’agit d’une hiérarchie arbitraire. Par exemple, le caviar, la truffe et le homard n’ont pas toujours été des mets de luxe. Jusqu’au Moyen Age, les Européens refilaient les œufs d’esturgeon aux cochons[9]. C’est l’élite russe émigrée en Europe au début du 20e siècle qui donna au caviar ses lettres de noblesse. Résultat, les riches ont commencé à en raffoler, donc surpêche et braconnage, donc les stocks se vident, donc le prix augmente, donc sa rareté lui confère du prestige. Même chose pour le homard : son abondance dans l’océan Atlantique, au large de l’Amérique du Nord, faisait du crustacé un produit banal, qu’on servait même aux prisonniers et qu’on utilisait comme engrais. Il gagne ses galons fin 19e, grâce au développement du chemin de fer : présenté comme un plat exotique dans les trains ralliant la côte ouest à la côte est, les passagers font grimper la demande, donc la pêche, donc la rareté. Prestige social + rareté = cherté = luxe = prestige social. La truffe, autrefois dédaignée en France, comme tous les champignons, prend l’ascenseur social au 18e siècle. Les laitages sont l’apanage des classes inférieures jusqu’au 18e siècle et le fromage ne se gastronomise qu’à partir du Second Empire[10]. Les légumes, eux, ont changé plusieurs fois de statut au cours de l’Histoire, tandis que la viande, longtemps réservée à la noblesse, n’est accessible au plus grand nombre que depuis le milieu du 19e siècle. Le canon gastronomique français est basé sur la cuisine bourgeoise, qui cherchait elle-même à imiter la noblesse. Or, « ce que l’on considère comme la bonne cuisine bourgeoise est en réalité, à ses origines, la cuisine du pauvre », écrit Madeleine Ferrières. Puisqu’ils sont une construction sociale, « les goûts changent : de populaires, certains plats deviennent raffinés, tandis que d’autres disparaissent des cartes et des cuisines[11] ». Même le triptyque occidental entrée-plat-dessert n’existe que depuis le 19e siècle, issu des restaurants gastronomiques. Sachant cela, parler de « tradition culinaire française » est presque un non-sens historique : à quelle période la fait-on démarrer ? Dans quelle région ? Pour quel type de population ? En France hexagonale, c’est l’invention de la « gastronomie », née après la Révolution, qui fait foi. Pour un territoire peuple depuis 1,8 million d’années, c’est un peu court… L’historien et sociologue Alain Drouard[12] affirme, du reste, que celle-ci est un mythe, c’est-à-dire « un récit imaginaire forgé à partir d’un ensemble de croyances et de représentations collectives sur la cuisine française, son excellence et sa prééminence séculaire par rapport aux autres cuisines nationales ». Ce mythe est né avec « le système de la cuisine française », soit « un ensemble de relations de dépendance entre trois acteurs principaux : les critiques gastronomiques, les cuisiniers et les amateurs de bonne chère ». L‘aristocratie, prescriptrice du bon goût (celui hérité de la Cour) et productrice de normes sociales, codifie tout ça avec des livres de cuisine « qui revendiquent l’identité de la cuisine française, définie comme cuisine aristocratique et bourgeoise, et affirment sa prééminence sur les cuisines étrangères ». Ces ouvrages, qui seront suivis au 19e siècle par les premiers guides gastronomiques (comme L’Almanach des Gourmands, de Grimod de la Reynière), sont avant tout des outils pédagogiques destinés à la nouvelle classe dominante (bourgeois et nouveaux riches) pour qui la maîtrise du « bon goût » est un instrument de pouvoir, de distinction et de reconnaissance sociale. Dans son best-seller fondateur, Physiologie du goût (1825), Brillat-Savarin énonce non seulement des préceptes à destination des classes dominantes (dont le célèbre « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es ») mais consacre la gastronomie comme une gastropolitique, voire comme une gastrodiplomatie, qui « contribue puissamment à la force et à la prospérité des empires ». En diffusant l’idéologie gastronomique française, les élites « consacrent ainsi les gens de goût comme des connaisseurs et des gourmets[13] ». Autrement dit : les gens bien mangent bien.
1. Ceci est une auto-promo éhontée pour mon précédent livre, Steaksisme – En finir avec le mythe de la végé et du viandard (Nouriturfu, 2021).
2. La Distinction, Pierre Bourdieu (Les Éditions de Minuit, 1979).
3. Op. cit.
4. Où va l’argent des pauvres, op. cit.
5. Ibid.
6. Claude Fischler, L’Homnivore (Odile Jacob, 1990).
7. Réalisé par Jerry Rothwell (Royaume-Uni, 2016). Mes documentaires préférés sont ceux où les possédants se retrouvent piégés par leurs propres stratégies de distinction et d’accumulation du capital: faux tableaux, faux bijoux, faux festivals…
8. L’Homnivore, op. cit.
9. Christian Millau, Dictionnaire amoureux de la gastronomie (Plon, 2008).
10. Madeleine Ferrières, Nourritures canailles (Seuil, 2007).
11. Op. cit.
12. Alain Drouard, Le mythe gastronomique français (CNRS Éditions, 2010).
13. Op. cit.
An excerpt from de Mangez les riches : La lutte des classes passe par l’assiette
© Nouriturfu, 2023