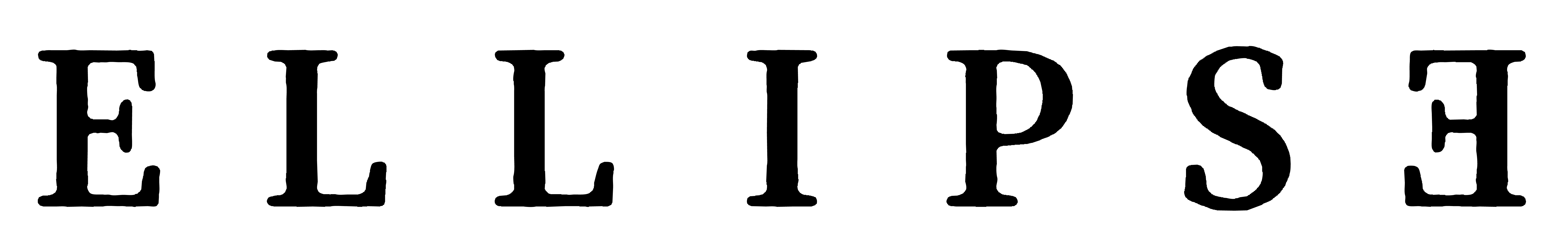“La cuisine” extrait de L’hygiène de l’absence de Simona Mancini
Rachel Martinez
Le souvenir de ma mère, je l’ai enterré vivant dans un coin de sa cuisine et il répand des odeurs de soupe. Des fragments de molécules remontent parfois par le nez, ils s’amalgament aux cellules et se faufilent jusqu’au cerveau. Ce souvenir se meut rapidement vers l’arrière, suivant des lignes invisibles parcourues des milliers de fois.
Elle sort d’un tiroir la nappe en coton jaune paille à motifs et de ses mains robustes, l’étale sur le comptoir froid en granit gris. Elle caresse ce rectangle de tissu comme une vierge lisse la couche nuptiale froissée par le plaisir des autres. Ensuite, elle scrute et mesure, déplace et redresse. Elle se retourne. Elle saisit les ustensiles, puis assiettes et verres défilent vers cette table pour un offertoire mélancolique. Cachée dans la dépense, je surveille chaque mouvement et je commence à compter : un, deux, trois… Mais je n’arrête pas.
On y accédait par une porte pliante ocre, la même couleur que la plinthe, les chaises cannées et les persiennes toujours fermées. Pareil pour les petits cadres qui avaient remplacé la photo de papa et ornaient la cheminée à la manière des scènes sur une tapisserie ancienne. J’éprouvais un malaise devant ces images sur liège mince clouées sur le crépi blanc. Les personnages solennels aux teintes criardes se détachaient sur un arrière-plan à peine esquissé, surpris dans la contemplation grave de leur destin : jeunes villageoises affairées à leur tamis ou penchées sur leur métier à tisser, musiciens, bergers au repos, une pipe rouge au bec. À l’abri dans l’obscurité, je cherchais leurs regards obliques indifférents, avec l’attente mêlée d’angoisse de celle qui interroge les arcanes du tarot en sachant ce qui s’en vient. Je m’inventais une nouvelle histoire en tirant d’autres cartes.
Je m’y précipitais au moindre prétexte et je demeurais là. Durant des heures, parfois. L’espace était si exigu que je devais rester debout, adossée contre les crochets pour les clés fixés au mur opposé à l’étagère. Les conserves se tenaient au garde-à-vous, en rangs serrés, soutenues par des tablettes en acier. En haut, l’huile et le vin, dans des dames-jeannes pansues cuirassées d’osier; au milieu, les bouteilles de sauce tomate casquées d’une capsule métallique; en bas, les pots de jardinières et de confitures avec leur bouchon hermétique vissé sur un bouclier en papier ciré. Je faisais l’inventaire de toutes les armes de cet arsenal. Je me préparais à livrer un combat pour ma survie parce que celui pour ma vie semblait irrémédiablement perdu. Une étiquette sur chaque récipient en mentionnait le contenu et la date de fabrication. Le moment venu, j’allais chercher les rectangles de papier dans le premier tiroir du meuble ancien, où se trouvait aussi le vieux cahier d’écolier dans lequel étaient notées les recettes. Je les tenais à plat sur les paumes de mes deux mains en attendant le regard d’approbation de maman, comme un chien espère sa récompense en serrant sa proie entre ses crocs. Elle enfonçait les pelures flétries dans l’entonnoir puis serrait le piston à deux mains, et les dernières gouttes de sauce rouge vermeil tintaient en tombant dans la bassine pleine.
C’estprêt! Ces deux syllabes crachées d’un trait trahissaient son immense fatigue de donner la parole à l’existence qui se poursuit. Je courais jusqu’à la chambre pour prévenir Gemma qui faisait ses gammes au piano. Je devais lui répéter deux ou trois fois alors qu’elle continuait à jouer, les yeux rivés sur les touches noires en s’efforçant de ne pas appuyer le pouce et le petit doigt. J’insistais. C’estprêt! Elle se levait du tabouret, hébétée, comme si j’avais été la seule à mesurer ce temps infini en retenant mon souffle au cas où un signal d’alarme proviendrait de la cuisine. Elle s’acharnait pendant des heures sur l’instrument, mais c’était vraiment le son opiniâtre, parfois rompu par une quinte de toux ou un craquement de jointures, qui trahissait son impatience. D’autres fois, il s’évanouissait, écrasé sous le poids de la pédale de sourdine. Alors je tendais l’oreille et il me semblait que derrière ce mur, il y avait aussi la sienne qui écoutait. Pendant ce temps, là-bas, une lame harcelait la pierre du comptoir, ondoyait sur les branches fibreuses du céleri ou fendait la pulpe juteuse des oignons qu’elle venait d’éplucher. La grande casserole en acier plantée lourdement sur le métal, la cuillère de bois plongeant avec légèreté dans l’eau déjà salée : le soffritto crépitait avant de s’étouffer dans un gémissement.
Quand c’était prêt, nous allions nous asseoir à nos places habituelles : Gemma et moi sur les longs côtés, une en face de l’autre, et maman dos à la cuisinière. Les serviettes, confectionnées dans un tissu coordonné à celui de la nappe, étaient pliées de manière à former une poche où étaient glissés couteau, cuillère et fourchette. On ne devait pas mettre de fromage sur les pois chiches et il était interdit de manger du pain avec les pâtes. Depuis toujours, parce que rien n’avait changé sur le formulaire du quotidien parfait et prévisible. Rien, outre cette présence rendue muette. Le plat dégageait autour de nos visages une dense vapeur d’arômes relevés, des souvenirs aigris au goût de rendez-vous manqué. Tête baissée, nous laissions refroidir la soupe en masquant, avec le tintement de la cuillère dans le bol, l’inquiétude vigilante de l’attente, l’angoisse impitoyable que nous infligeait cette table encore dressée pour quatre.
Autrefois, les bruits parvenaient jusqu’à nous sans prévenir, nécessaires comme un souffle qui suit un souffle. Si papa était sur le point de revenir, nous nous accroupissions dans l’entrée. Nous entendions la porte de l’immeuble se refermer en claquant, ses pieds pressés avaler l’escalier trois marches à la fois, puis la clé s’insérer d’un geste décidé dans le trou de la serrure en laiton. Il le savait que nous étions là, à l’attendre, et pourtant, il tombait dans notre embuscade à tout coup. Il levait les mains en signe de reddition puis s’agenouillait sur le plancher, se laissant ébouriffer les cheveux et froisser l’uniforme. Et puis, il se libérait en nous serrant fort, une à gauche, l’autre à droite. Son visage s’ouvrait alors, vaste comme une plaine au sommet d’une côte. Un sentier accidenté, inégal et aéré, y menait : nous le gravissions et le descendions avec nos doigts et nos baisers, nous le parcourions ensemble, en sœurs.
Qu’est-ce qu’on mange ce soir? demandait-il en reniflant les arômes pendant qu’il nous tenait toujours assises dans le creux de ses bras. Devine. Nous aimions lui lancer le défi de nommer les ingrédients en troquant des indices faciles contre quelques promesses. C’est pour ça que maman surgissait, l’index sur la bouche, en lui interdisant d’espionner. Elle le faisait du seuil de la cuisine, de ces limbes, de cette délimitation entre son temps à elle et le reste du monde. Devine. Parfois, elle nous devançait, le visage sérieux. Elle semblait l’implorer de saisir des signes dans l’air ambiant pour en tirer un présage. Et s’il hésitait un peu, une ombre, un léger voile d’angoisse qui pouvait se muer en terreur, tombait alors sur sa douceur sereine. Devine voulait dire devine-moi.
Rachel Martinez tient à remercier La Casa delle Traduzioni à Rome et le Conseil des arts du Canada de leur soutien.
La cucina (L’Igiene dell’Assenza)
Il ricordo di mia madre l’ho sepolto vivo in un angolo della sua cucina e spande odore di minestre. Frammenti di molecole risalgono a volte dal naso, si fondono con le cellule e s’insinuano fino al cervello. Di spalle si muove svelta lungo linee invisibili, mille volte percorse. Da un cassetto estrae la tovaglia di cotone color fieno, a fantasie, e con le mani robuste la distende su un banco gelido di granito grigio. Accarezza quel rettangolo di stoffa come la vergine racconcia un talamo sgualcito dal piacere altrui: poi scruta e misura, sposta e raddrizza. Torna indietro. Afferra le posate e piatti e e bicchieri sfilano verso quella mensa, in un cupo offertorio. Nascosta nel ripostiglio sorveglio ogni mossa e inizio a contare: uno due tre …. Ma è una conta al rialzo.
Vi si accedeva da una porta a soffietto color ocra. Lo stesso colore dello zoccolo battiscopa, delle sedie impagliate e delle persiane sempre chiuse. Lo stesso dei quadretti che ormai stavano al posto della foto di papà e istoriavano il camino alla stregua delle scene di un arazzo. Provavo fastidio per quei sugheri sottili, inchiodati all’intonaco bianco. Figure solenni dalle tinte chiassose campeggiavano in uno spazio appena accennato, assorte nella contemplazione grave del loro destino: villanelle intente al setaccio o al telaio, musici, pastori a riposo con la pipa rossa. Protetta dal buio cercavo i loro sguardi obliqui, indifferenti, con l’angoscia mista ad attesa di chi interroga gli arcani. Mi fingevo una nuova stesura, riaggiustando il tiro alla sorte.
Con qualche scusa mi ci ficcavo di volata, e ci restavo. Per ore, a volte. Lo spazio era così stretto che dovevo rimanere in piedi, le spalle addossate ai ganci portachiavi fissati sulla parete opposta allo scaffale. Sorrette da mensole d’acciaio, stavano sull’attenti, a ranghi serrati, le conserve: in alto l’olio e il vino, in grosse damigiane corazzate di vimini, al centro le bottiglie di pomodoro, elmate a corona, in basso giardiniere e confetture, con la chiusura ermetica e uno scudo di carta oleata. Di quella polveriera passavo in rassegna ogni arma. Mi preparavo alla guerra per la sopravvivenza: quella per la vita sembrava irrimediabilmente perduta. Su ciascun recipiente un’etichetta indicava il contenuto e la data. Quando era il momento, andavo a cercarle nel primo cassetto del mobile antico, dove stavano pure le ricette, annotate su un vecchio quaderno delle elementari. Portavo le targhe adesive adagiate su i palmi di entrambe le mani e aspettavo uno sguardo di mamma, come un cane aspetta il premio con la preda stretta tra i denti. Mentre affondava le bucce aggrinzite dentro l’imbuto, schiacciando a due braccia il pistone, le ultime gocce tintinnavano nella bagnarola inondata di salsa vermiglia.
Epprónto! In quelle sillabe sputate d’un fiato c’era l’immensa fatica di dar voce all’esistere ancora. Correvo in camera ad avvisare Gemma, che eseguiva le scale al pianoforte. Dovevo ripeterglielo due o tre volte mentre continuava a spingere i tasti, lo sguardo fisso ai diesis nello sforzo di non appoggiare il pollice e il mignolo. Epprónto! insistevo. Si alzava dallo sgabello stordita, come se io sola avessi misurato quel lasso infinito trattenendo il respiro, in caso un segnale di allerta giungesse in anticipo dalla cucina. Si accaniva per ore sullo strumento, però era proprio il suono ostinato a tradirne l’attesa. A volte era rotto da un colpo di tosse o da uno scrocchiare di nocche; a volte svaniva schiacciato sotto il peso della sordina. Allora tendevo l’orecchio e mi pareva che dietro quel muro, all’ascolto, ci fosse anche il suo. Intanto, di là, una lama incalzava la pietra, ondeggiava sui cespi fibrosi del sedano o squarciava la polpa succosa delle cipolle appena sfogliate. Sul ferro piombava l’acciaio di un grosso tegame, il legno nuotava leggero nell’acqua appena salata: crepitava il soffritto e poi si smorzava in un grido sfumato.
Quando era pronto andavamo a sederci ai soliti posti, Gemma e io sui lati lunghi, una di fronte all’altra, mamma, invece, dalla parte dei fornelli. Le salviette, in tessuto coordinato con la mappa, erano piegate a formare una tasca in cui stavano coltello, cucchiaio e forchetta. Sui ceci non si doveva mettere il formaggio mentre con la pasta era proibito mangiare anche il pane. Da sempre. Perché nulla era cambiato nel formulario perfetto di prevedibilità quotidiana. Nulla, a parte quella presenza azzittata. Il piatto ci fumava in faccia un vapore denso di aromi pungenti, memorie inacidite che avevano il gusto di un appuntamento mancato. A testa bassa lasciavamo raffreddare la zuppa camuffando dietro il tintin del cucchiaio nella scodella l’inquietudine vigile dell’attesa, l’angoscia spietata che ci infliggeva quella tavola ancora apparecchiata per quattro.
Prima i rumori ci arrivavano addosso senza avvisare, necessari come il respiro che segue al respiro. Se papà stava per rientrare ci acquattavamo dietro l’ingresso. Sentivamo il portone giù in basso richiudersi con un clac, il suo piede spedito ingoiare i gradini tre a tre e la chiave infilarsi decisa nell’ottone della serratura. Che fossimo là ad aspettare lui lo sapeva, eppure ogni volta cedeva all’agguato. Alzava le mani in segno di arresa e in ginocchio sul pavimento si lasciava sgualcire capelli e divisa. Poi si affrancava così, stringendoci forte, una a sinistra una a destra. La sua faccia allora si apriva come una piana dopo un cammino in salita. Lì passava un sentiero sconnesso, ruvido e aprico: andavamo su e giù con le dita e coi baci, percorrendolo insieme, sorelle.
Che si mangia stasera, chiedeva indagando col naso mentre ci teneva ancora sedute nell’incavatura del braccio. Indovina. Ci piaceva lanciargli la sfida degli ingredienti e concedergli facili indizi in cambio di qualche promessa. Per questo mamma arrivava di corsa e affacciandosi dalla cucina intimava di non fare la spia, con l’indice dritto davanti alla bocca. Lo faceva da lì, da quel limbo che la soglia marcava tra il mondo e il suo tempo. Indovina. A volte ci precedeva, e allora era seria. Sembrava implorarlo di cogliere segni nell’aria e trarne un auspicio. E se lui un poco esitava, sulla sua dolcezza pacata calava un’ombra, un velo sottile d’angoscia che poteva mutarsi in terrore. Indovina valeva indovinami.