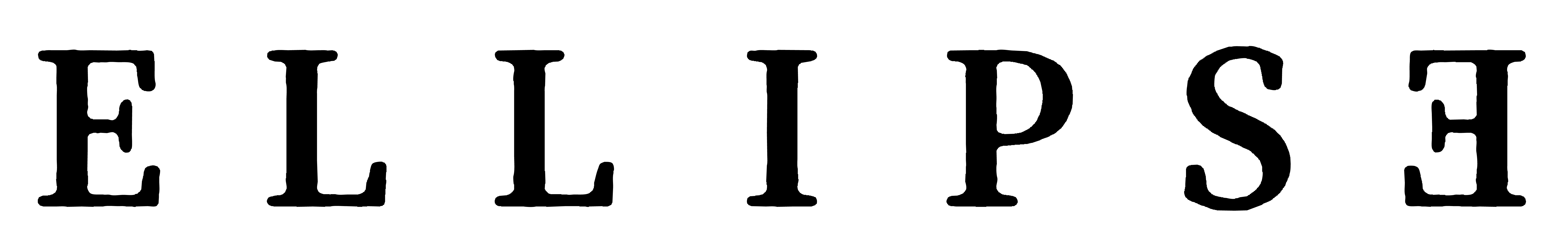Postface
Par Jean-Marcel Morlat
Traduire un poème répond à la seule injonction du désir, du plaisir, de la liberté d’être soi dégagé du carcan circulaire du moi replié sur soi-même.
(Verhesen, 2003, p. 19).
By giving it form, making it new, forcing us out of the lexicalized verities that have gone stale on us, poetry makes us feel our way to new truths, or to a gut knowledge of old ones.
(Folkart, 1999, p. 42)
C’est en 2017, par amour des nouvelles et de la traduction, et un peu par hasard tout de même, que je suis tombé sur la nouvelle de Patrick Lane, « Natural History4 », dans Best Canadian Short Stories (2004). C’est aussi la fascination que je ressens pour le Moyen-Orient, où j’ai vécu de nombreuses années (Turquie, Émirats arabes unis) et beaucoup voyagé (Syrie, Jordanie, Liban et Oman), et l’intérêt que j’ai toujours éprouvé pour T. E. Lawrence et son livre, Les sept piliers de la sagesse5, qui m’ont poussé à entreprendre la traduction de cette nouvelle. Lorsqu’il lui fut présenté, Patrick Lane accueillit mon projet avec une grande chaleur et me donna son autorisation, me permettant ainsi de repartir, par textes interposés, en voyage vers l’une de mes contrées de prédilection, de franchir des déserts tout en me taillant un passage vers la Colombie-Britannique. « This is one of my favourite pieces of writing. I am very happy you are translating it », m’avait-il écrit le 24 septembre 2017. J’allais maintenant voyager en chambre, depuis le Canada, dans les replis du texte qui me propulsait vers des lieux connus et aimés. Histoire naturelle a paru dans le no 154 (hiver 2019) de la revue québécoise Les Écrits (de l’Académie des lettres du Québec). Patrick Lane, après une longue maladie, s’était éteint le 7 mars 2019, sans avoir pu tenir la revue dans ses mains.
Je m’étais déjà délecté du recueil de nouvelles How Do You Spell Beautiful?: And Other Stories (Fifth House, 1992), projetant d’en traduire certaines, mais j’avais tenu sa poésie à distance, peut-être un peu par crainte de ne pas être à la hauteur, quelque peu terrorisé par ces textes faussement simples. Patricia Godbout résume mon sentiment à merveille : « La poésie canadienne-anglaise contemporaine est riche et multiforme. S’y font entendre les voix d’hommes et de femmes s’exprimant le plus souvent dans un idiome dont l’apparente simplicité est trompeuse. » (Godbout, 2000, p. 54) De fil en aiguille, j’ai commencé à apprivoiser la poésie de Patrick Lane et me suis mis, dans un véritable état de transe, à traduire certains de ses textes. Lorna Crozier, son épouse, aux anges, m’a beaucoup encouragé. Je me suis alors senti comme adoubé. La poésie de Patrick Lane m’est, pour tout dire, devenue indispensable d’un point de vue littéraire et spirituel, peut-être aussi parce qu’elle me donne une lecture fondamentale du monde. Comme le dit Barbara Folkart : « poetry is carnal knowledge of the world. Knowing through sensory inputs of all sorts (as opposed to categorical perception) is a fundamental way of “knowing new”. » (Folkart, 1999, p. 41). Fernand Verhesen, dans son petit livre À la lisière des mots – Sur la traduction poétique, résume cette appétence qu’éprouve le traducteur pour la poésie :
Le choix qu’il fait de traduire certains poèmes ne répond nullement à une sorte de manque compensatoire, comme on l’a suggéré. Il répondrait plutôt au désir ou au besoin qu’éprouve le traducteur de faire l’expérience d’une autre identité, non pour enrichir égoïstement la sienne (encore que cet enrichissement soit énorme), ni pour s’en revêtir comme d’un déguisement, mais pour trouver en soi la confirmation que l’acte poétique ne peut advenir, ne peut se vivre, qu’au confluent, au croisement, d’identités multiples et diverses. Bien sûr, certaines affinités sensibles ou mentales déterminent souvent le choix des œuvres à traduire, mais il peut aussi bien être suscité par de stimulantes divergences. » (Verhesen, 2003, p. 8).
Les traductions naissent des rencontres, les textes se tutoient, se prolongent et mènent à d’autres textes. La nouvelle « Histoire naturelle » est née d’un dialogue entre Patrick Lane et Gwendolyn MacEwen, qui y est omniprésente. Son ombre se dresse derrière les mots, ses doutes, sa solitude et ses inquiétudes aussi. On peut en effet y lire : « Les histoires sont des fragments de nous-mêmes à partir desquels nous construisons une vie, et si elles ne sont pas transmises, alors nos vies sont perdues. Gwen savait cela dans son petit corps inquiet. Elle connaissait des histoires perdues; je sais qu’elle en a emporté certaines dans sa tombe. Nous avons tous les deux passé de nombreuses années sur des chaises solitaires dans des pièces à attendre que quelqu’un vienne nous poser la question qui changerait nos vies. » (Lane, 2019, p. 33). Dans « Pour Gwendolyn MacEwen », Patrick Lane nous raconte aussi une histoire et reprend ce dialogue (ce questionnement) interrompu avec elle en se remémorant un moment précis : on sent son affection pour la poétesse trop tôt disparue (« Tu n’arrêtais pas de balayer de la main une mèche de cheveux qui te retombait sur les yeux. J’adorais ton rire. »); on comprend leur amour commun des cirques et des « monstres », des gens extraordinaires (dans le sens originel du terme) dont naissent les histoires. Patrick Lane se confie aussi et évoque ses démons : l’errance et l’alcool (un autre point commun avec Gwendolyn MacEwen). Il nous parle de son amour de la poésie et de la difficulté d’appréhender le genre, de transmission et d’enseignement, de la nécessité d’aller au-delà des mots. Il nous parle de l’acte d’écriture : le texte est autoréférentiel et généré par un écrivain dont le traitement de texte est rétif, indomptable, un peu comme la poésie par moment. Lane tisse aussi un fort tissu intertextuel, nous renvoie à deux autres poèmes de Gwendolyn MacEwen: « Dark Pines under Water » et « Manzini: Escape Artist », deux poèmes forts qui nous offrent une certaine vision du monde.
Lors d’une lecture publique de « Dark Pines under Water », Gwendolyn MacEwen avait affirmé : « Pour moi, le Canada est encore un pays mystérieux sans véritable histoire, ce qui fait que nous devons plonger dans les lacs et les forêts pour nous construire une sorte de passé.6 » Ce poème est en fait un voyage intérieur, une plongée (douloureuse?) dans notre inconscient visant à comprendre et à recréer un monde archétypal (elle avait beaucoup lu C. G. Jung) par le biais de l’écriture, le paysage physique symbolisant notre intériorité. Nous sommes invités non seulement à fouiller le paysage canadien, mais aussi à décrypter nos propres expériences intérieures, notre mythologie intime. Il s’agit bien d’une vision en clair-obscur. Barbara Folkart ne nous dit pas autre chose dans cette réflexion percutante : « the business of poetry is to probe deeper into the as yet unconceptualized grain of experience, the hidden layers of our being in the world. By the end of a (successful) poem, the poet winds up knowing more than she thought she knew at the outset. The initial intuition (whether you want to think of it as a gift from the gods, or as sewerage backing up from the unconscious mind) unfolds into a statement that makes sense of at least some small part of the world. » (Folkart, 1999, p. 32-33).
Gwendolyn MacEwen était, on le sait, fascinée par les magiciens dont elle allait voir les spectacles dans les théâtres de Queen Street à Toronto : Harry Blackstone7, Sid Lorraine8 et Mario Manzini, qui est d’ailleurs toujours actif et lui écrivit même une lettre. Dans le cadre d’une lecture de son poème, « Manzini: Escape Artist », Gwendolyn MacEwen avait expliqué : « Le poème suivant a été écrit juste après que j’ai assisté à une représentation donnée par un jeune virtuose de l’évasion à l’Exposition nationale canadienne il y a quelques années de cela. J’ai été frappée par le profond lyrisme avec lequel il s’est extrait des cordes et des chaînes, et je me suis mise à me demander si sa prestation n’était peut-être pas une démonstration plus claire du combat pour la liberté personnelle que chaque poème pourrait bien être.9 » Rosemary Sullivan, dans Shadow Maker: The Life of Gwendolyn MacEwen, la biographie qu’elle a consacrée à Gwendolyn MacEwen écrit : « Gwendolyn felt she was a fellow adept in the trade of magic, and that her art was no less pragmatic than theirs. What was important was that it existed on the same knife-edge between reality and illusion, and depended on the same principle, the spectacular suspension of logic. Because, of course, logic was the same straitjacket that she did not believe in. As with Manzini, for her what the world called illusion was the more real. She wanted “to push through reality and come at it from the other side,” she once told a friend10. Poets were “magicians without quick wrists,” their tools of magic the same11. If the magician was working in visual parables, the poet worked in verbal parables—Manzini’s chains, as she identified them in the poem she wrote for him, were the chains of flesh. » (Sullivan, 1995)
Traduire un texte poétique relève toujours de la gageure (il nous faut, nous aussi, nous extraire de certaines chaînes pour retrouver notre liberté de mouvement), mais il s’agit surtout de procéder avec méthode. Lorsque je traduis un poème, je pars tout d’abord en quête d’informations sur l’auteur et son œuvre : j’ai ainsi lu la substantielle biographie de Gwendolyn MacEwen, d’une grande subtilité, et une anthologie de ses poèmes; j’ai également vu le documentaire bouleversant de Brenda Longfellow, Shadow Maker: The Life of Gwendolyn MacEwen, et consulté des vidéos sur YouTube. En ce qui concerne Patrick Lane, le terrain était déjà bien balisé. Ensuite, je réalise une analyse lexico-sémantique et grammaticale du poème, puis je réfléchis aux différents aspects linguistiques propres à la langue de départ et à la langue d’arrivée : j’ai constamment recours aux dictionnaires en ligne, Le Trésor de la langue française informatisé notamment, qui me permet de traquer les mots rares, les synonymes, cela grâce aux nombreux exemples littéraires que l’on y trouve. Je recours aussi à différents dictionnaires bilingues (en format numérique et papier) et dictionnaires des synonymes. Comme le précise Fernand Verhesen : « Il s’agit, au départ de toute traduction, d’avoir assimilé au mieux la langue d’usage de l’auteur, ce qui est de toute évidence fondamental, et de condamner toute adaptation à partir d’une version littérale fournie par un intermédiaire. Mais il est également indispensable et infiniment plus difficile de se mouvoir dans la langue spécifique, et davantage encore dans le langage propre d’un poète particulier, en même temps que dans un univers sensible et mental. » (Verhesen, 2003, p. 8-9). Arrive ensuite le moment de rédiger le brouillon de la traduction incorporant les résultats des premières étapes, mais sans me préoccuper de la forme du poème, dont je me soucie durant l’étape finale qui consiste à peaufiner mon texte, à le poser, puis à le reprendre (cette multitude de brouillons qui montrent le traducteur ou l’écrivain à l’œuvre, comme l’a si bien montré la critique génétique). Bien sûr, ces différentes étapes ne sont pas cloisonnées : il y a des allers-retours, des fulgurances inattendues, fruit d’une lente maturation. Comme le dit si bien Roland Maisonneuve : « Même la trouvaille qui jaillit en un éclair est le fruit d’un labeur silencieux, continu, qui se poursuit dans l’esprit du traducteur sans qu’il en ait conscience. » (Maisonneuve, 1978, p. 76). Que de doutes, d’enlisements, de va-et-vient entre la forme et le fond12, de détours inattendus et de révélations lexicales au saut du lit après que la nuit a porté conseil ou au détour d’un sentier lorsque la promenade, nécessaire, se fait poétique. Les réponses sont parfois cachées dans les livres que l’on lit : tel mot sur lequel on trébuche en anglais, apparaît alors en français lors d’une lecture n’ayant aucun lien avec notre travail de traduction. Comment dire les choses autrement et se libérer du diktat des modèles qui nous sont imposés à notre corps défendant? La poésie nous invite à nous extirper de notre camisole de force et à faire du neuf avec de l’ancien, que l’on soit poète ou traducteur, ou les deux à la fois : « Poetry, like any other radical cognitive undertaking, challenges the templates on which categorical perception is founded, tries to deracinate our deep-rooted preferences for what we have previously been exposed to. Templates are inherently abstractions arrived at by filtering out any aspects of the real considered irrelevant to the business at hand. But the new is always on the fringes of the business at hand—the new is what got filtered out when the previous set of templates formed. » (Folkart, 1999, p. 37).