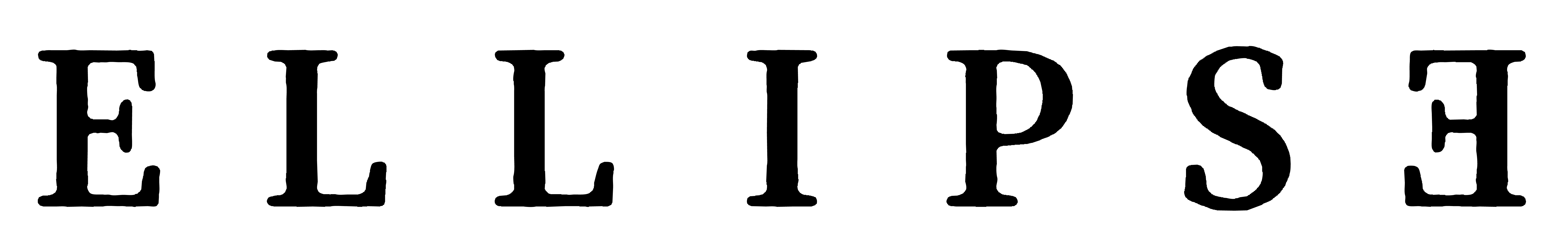Saisir le feu de Daniel Hahn
Rachel Martinez
Mise en contexte
Le texte soumis est un extrait de l’introduction de Catching Fire du traducteur littéraire britannique Daniel Hahn. Il s’agit d’un journal qu’il a tenu pendant trois mois et demi au début de 2021 au cours de la traduction du roman Jamás el fuego nunca de la Chilienne Diamela Eltit. Il décrit son processus de traduction de l’intérieur, avec humour, simplicité et honnêteté. Ce journal a été initialement publié en ligne, sur le site de Charco Press, alors même que la traduction était en cours. J’ai réuni les passages de l’introduction traitant plus particulièrement de l’invisibilité des traducteurs et traductrices.
Saisir le feu(1), journal d’une traduction
Introduction
Je suis traducteur littéraire.
Très bien, me direz-vous, mais qu’est-ce que cela implique réellement ? Eh bien, en quelques mots, mon travail consiste à lire un livre en langue A et à le réécrire en langue B. Je lis le texte avec toute la sensibilité, l’intuition et le sens de l’analyse que je peux lui apporter, puis je crée une chose nouvelle, identique au livre original, sauf pour les mots. Une chose nouvelle qui permettra à une œuvre que j’ai aimée d’aller à la rencontre d’autres lecteurs.
On pourrait être intimidé par l’acte de traduire, le considérer comme un miracle d’une complexité déconcertante, mais abordons les choses autrement. Après tout, sur le plan le plus élémentaire, la traduction se résume à deux démarches plutôt simples : traduire, c’est lire et traduire, c’est écrire. Dans un sens, ce n’est rien de plus. Le traducteur lit un ouvrage, puis en écrit un autre. Il lit un roman dans l’espagnol de Diamela Eltit, par exemple, puis rédige quelque chose dans son anglais à lui. Rien de très compliqué, n’est-ce pas ?
Ainsi, lorsqu’une traductrice travaille à un texte, elle traite généralement avec deux langues, mais elle s’investit dans chacune d’elles d’une manière totalement différente. Elle assimile la langue A et génère la langue B. Inspiration… Expiration… La traductrice doit être, à tout le moins, une brillante lectrice dans une langue et une brillante autrice dans l’autre. Évidemment, chacune de ces tâches peut être exigeante en soi. Nous déployons tous les efforts nécessaires pour comprendre ce qui se produit dans une phrase écrite en grec, en tamoul ou en gallois – pour déterminer ce qu’elle signifie, ce qui se passe au-delà des simples mots de la langue A – puis nous mobilisons l’ensemble de nos compétences les plus fines en langue B pour réécrire ce texte en vietnamien, en coréen ou en néerlandais. Les traducteurs sont donc des hybrides : ils appartiennent à une race particulièrement étrange de lecteur doublée d’une race particulièrement étrange d’auteur. Ils lisent à travers une pellicule de mots pour découvrir ce qui se trouve derrière puis ils écrivent cette chose. Ils lisent Die Prinzessin auf der Erbse et, derrière le voile des mots, ils voient… une princesse et un petit pois. Ensuite, ils racontent cette histoire.
[…]
Une image est couramment utilisée pour décrire notre travail : nous sommes tels des acteurs jouant un rôle. Ou alors, nous sommes des ventriloques. Ou encore des prête-plumes, des bâtisseurs de ponts, des funambules, des cheffes d’orchestre, des contrebandières, des ombres, des arrangeurs musicaux ou des caméléons. Chaque traducteur a sa métaphore favorite pour exprimer les exigences et les joies de son étrange profession, une métaphore qui rend bien la notion d’interprétation, la souplesse, la relation de dépendance au texte de départ, les possibilités et les impossibilités de sa tâche. Ces comparaisons n’offrent guère plus qu’une correspondance partielle, mais elles peuvent néanmoins être utiles.
Ma métaphore préférée ? Traduire, c’est semblable à copier une œuvre d’art au moyen d’une technique différente. Nous sommes des faussaires qui tentent de reproduire un tableau à l’huile en utilisant uniquement des crayons, mais si habilement que personne ne pourrait distinguer l’original de la réplique. Imaginez que nous copions une aquarelle avec des pastels ou un dessin au fusain avec une plume et de l’encre. Nous voulons que le résultat soit le même, mais nous ne pouvons pas nous contenter d’imiter successivement chaque coup de pinceau. Chaque technique, comme chaque langue, a ses atouts et ses capacités propres. Différentes manières de créer une impression de lumière, de perspective, de densité ou de texture. Il en va de même pour les langues. Lorsque nous écrivons un texte en anglais, nous avons recours à un ensemble d’outils distincts de ceux d’une hispanophone, mais nous voulons que l’impression reste la même, d’une façon ou d’une autre. C’est dans ce « d’une façon ou d’une autre » que résident la compétence de la traductrice et le mystère apparent de sa tâche, bien sûr.
C’est bien ce qui nous complique la vie, n’est-ce pas ? Préparer un sandwich au fromage n’a rien de sorcier, mais concocter quelque chose qui reproduit précisément le goût, l’odeur, la texture et l’arrière-goût d’un sandwich au fromage en n’utilisant ni pain, ni beurre, ni fromage… Quand j’entreprends la traduction d’un roman chilien, par exemple, je sais que je devrai le recréer aussi exactement que possible, sauf que – et c’est là le problème – je n’ai pas le droit d’utiliser un seul mot d’espagnol. Et l’anglais n’est pas pareil ! Aucun mot d’une langue ne correspond parfaitement à un mot d’une autre langue, et chaque langue a ses points forts et ses points faibles. Admettons que l’on remplace le mot français x par le mot anglais y. On pourrait penser que y est un bon substitut, une trouvaille brillante même. Le mot y pourrait effectivement être plus intéressant ou produire un meilleur effet que x, mais y ne sera jamais x.
[…]
L’ancienne mannequin et star médiatique Katie Price(2) – dont l’apparition dans cette introduction en surprendra plus d’un – est présentée comme l’autrice d’un certain nombre d’ouvrages. Cette conception du rôle d’« autrice » m’interpelle. Comme le rapportait le tabloïd britannique The Sun : « Katie est honnête et ne prétend pas écrire les livres elle-même. Elle explique qu’elle trouve les intrigues et les personnages, et confie la dactylographie à quelqu’un d’autre. » Je considère, en tant que traducteur, que « la dactylographie » est très importante.
Quelqu’un d’autre nous explique à nous, traducteurs et traductrices, ce que notre phrase doit faire – disons transmettre un élément d’information sur un personnage, mais de manière très succincte, dans une voix distincte d’un registre élevé qui laisse transparaître un léger scepticisme, un brin de persil entre les dents(3) et un phrasé élégant soulignant le contraste avec la phrase-choc abrupte qui suit – et nous devons simplement déterminer comment y parvenir au moyen de notre langue à nous. Nous lisons le livre A, puis nous écrivons le livre… A. (Le livre A et le livre A n’ont aucun mot en commun, mais sont par ailleurs identiques.)
C’est tout un défi d’écriture. Et le plaisir, pour moi, c’est justement l’écriture. C’est à la fois un nouvel écrit et une réécriture. On pourrait dire que j’écris le livre que, d’après moi, l’autrice aurait écrit si elle avait écrit en anglais. Autrement dit, c’est l’autrice – et elle seulement – qui détermine ce qu’est le livre. Moi, je suis seulement le type qui arrive à la fin pour le dactylographier à sa place.
[…]
On dit constamment aux écrivains en début de carrière que leur tâche la plus importante consiste à trouver leur voix. Toutefois, l’une des choses qui nous distingue, nous les traducteurs, de la plupart des romanciers et des poètes, par exemple, c’est qu’en nous lançant dans le métier, la difficulté n’est pas de trouver notre voix, mais de la perdre. En la perdant – un art qui peut être passablement ardu à maîtriser, rappelez-vous Elizabeth(4)… –, nous pouvons nous mettre sans entraves en quête de celle d’une autre personne. Mais ce qui est souhaitable, c’est que l’auteur ou l’autrice ait effectivement sa voix propre, distincte, dans toutes ses œuvres traduites. […]
La traduction n’est jamais un acte neutre, bien entendu. Elle ne peut se faire sans contexte, sans interprétation ni personnalité, même si l’on pense ne laisser aucune empreinte. En essayant d’écrire la même chose qu’un écrivain, une traductrice fera appel, dans une mesure variable, à sa propre créativité, à sa propre perspicacité, à sa propre adresse à manier la langue pour recréer ingénieusement tout ce que la langue de départ accomplit naturellement, mais dans une autre langue qui fait tout différemment. Bref, écrire le livre de quelqu’un d’autre, mais à l’envers et en talons hauts.
[…]
Un texte traduit est le fruit d’une somme de choix, des choix plus ou moins convaincants, plus ou moins justifiables, mais toujours subjectifs, puisque chaque traducteur est un lecteur qui interprète et un auteur qui crée, plutôt qu’une base de données lexicographiques ou un répertoire d’algorithmes. Ainsi, une fois notre lecture terminée, nous nous attaquons au vrai travail : celui d’écrire. Il s’agit de trouver des moyens créatifs de reconstruire quelque chose qui soit tout aussi spirituel/élégant/hirsute/anachronique/languissant/ironique/fuyant/laborieux ou acrobatique que le texte de départ, et exactement de la même manière.
Mais, comme je l’ai dit, comment pouvons-nous nous en sortir puisque les langues sont toutes différentes – et donc la traduction impossible ? Eh bien, nous y arrivons parce que toute traduction réussie est aussi un tour de passe-passe. Pendant qu’une personne lit une de mes traductions, je ne tiens pas particulièrement à ce qu’elle soit consciente de mon rôle dans le processus. Je ne veux pas qu’elle pense à la couche supplémentaire que j’applique, au rôle de médiation que je joue, dans son rapport avec l’auteur du texte de départ. Je souhaite en quelque sorte qu’elle ait l’impression de lire l’original. C’est, à mon avis, ce que devrait être l’expérience de tous les lecteurs et lectrices d’œuvres traduites. Demandez à des anglophones s’ils ont lu Madame Bovary de Flaubert et ils devraient répondre par l’affirmative sans hésitation, même si, à vrai dire, ils ont seulement lu une version écrite par une Américaine de notre époque. (Ce « seulement » est tendancieux, je sais.) L’idéal ? Ce serait, à mon avis, qu’un lecteur arrive à la dernière phrase de Never Did the Fire de Diamela Eltit et pense : « Wow, mais attendez… attendez une seconde. Je ne comprends pas l’espagnol ! Que s’est-il passé ? »
Bien entendu, si on vous pose la question, vous savez parfaitement bien qu’il s’agit d’une traduction. Il n’y a aucun doute dans votre esprit. Dans le même ordre d’idées, si vous interrompez une représentation de Hamlet, les spectateurs vous diront que cet homme sur la scène n’est pas vraiment le prince du Danemark. C’est juste un type qui fait semblant, mais s’il s’y prend bien, tant que nous sommes dans l’histoire, nous habitons la pièce comme s’il était le vrai prince du Danemark, sans intermédiaire. Sans médiation, dirais-je plutôt. Les lecteurs doivent avoir l’impression de bénéficier d’un accès direct à une œuvre d’art, même s’ils savent que ce n’est pas le cas dès la tombée du rideau. Évidemment, ça ne nous empêche pas de nous interroger sur la fonction de l’interprète dans notre expérience ni de l’apprécier. Cette impression d’accès direct à la création d’un écrivain doit tout de même rester authentique à ce moment-là : la traduction/performance n’en est pas un substitut, mais bien une révélation. Toutefois, la réexpression d’une œuvre est-elle vraiment identique à l’originale ? Non, et jamais elle ne pourra l’être. C’est ce que je disais : un tour de passe-passe.
Il s’agit en fait d’un nouveau texte avec lequel on cherche à créer les mêmes effets que l’original au moyen d’outils entièrement différents. Et la façon dont cela fonctionne (cette étrange fidélité dont nous parlons tant) est un autre beau petit paradoxe : pour que le texte reste pareil, nous devons le transformer complètement.
Je considère donc la traduction comme un acte d’optimisme. Plutôt que de parler en termes de perte et de se demander ce qui n’est pas transmis ou en quoi la traduction est inférieure au texte de départ, il est rafraîchissant de réfléchir au contraire, comme nous le faisons constamment, nous les traducteurs et traductrices. Qu’est-ce qui survit dans la traduction ? Et en particulier, comment se fait-il qu’un aspect de l’expression comme le « style », que nous associons si étroitement aux caractéristiques propres à l’activité linguistique, survive après avoir été complètement arraché d’une langue pour être reconstitué dans une autre ? La prose de Diamela, par exemple, possède un style littéraire très particulier. Voilà bien une entreprise optimiste, si tant est qu’elle existe.
Il convient de mentionner qu’avec ses multiples stratégies qui nous permettent de faire des gains, la traduction peut être une entreprise militante puissante, et pas simplement réactive, silencieuse ou soumise. La traduction consiste à faire entendre davantage certaines voix, à repousser les limites jusqu’au point de rupture, à remettre en question l’idée facile et bon marché qu’une culture nationale est monolithique, une idée creuse comme le savent tous les traducteurs… et tous les lecteurs. (Je n’arrive pas à imaginer pourquoi une culture serait volontairement hermétique, unidimensionnelle et exsangue plutôt que poreuse, vaste et foisonnante. Cela m’échappe vraiment. Et pourtant, voilà où nous en sommes.) Tout en reconnaissant la présence de frontières linguistiques et culturelles, la traduction considère qu’il existe des choses plus importantes. Elle célèbre la langue, mais se construit à partir d’éléments qui la transcendent : la tolérance, la compréhension mutuelle, le transfert d’idées progressistes et l’innovation. Toutes ces réalités qui permettent aux cultures de prospérer peuvent, parfois, être acquises grâce à la traduction et intégrées dans ce travail de l’esprit.
Je considère aussi la traduction comme un art qui vise un idéal en quelque sorte prédéterminé. Le processus consiste donc à tendre vers cette chose, à essayer de s’en approcher, aussi près que le permettent les différences entre les langues, les compétences personnelles et les circonstances. Je ne crois pas que l’on puisse signer la traduction parfaite d’un roman, évidemment, mais je sais ce qui, théoriquement, la caractériserait si une telle chose était possible. J’ai une idée de ce à quoi elle ressemblerait. (Ou plutôt, de ce qu’elle ferait ? Si la fidélité est une notion d’une quelconque utilité, ce que je recherche, c’est la fidélité à ce que j’imagine être l’effet du texte de départ.) Cela n’implique pas que l’on doive comparer chaque traduction à sa perfection théorique et la trouver inévitablement défaillante. S’agirait-il simplement d’être clair sur la direction à prendre ? Il y a un horizon impossible à atteindre vers lequel le processus s’oriente progressivement, une version de la traduction à la fois. L’idée – abstraite, encore une fois – de ce qu’est la traduction déterminera le critère sous-tendant ces innombrables choix. Laquelle de ces deux options me rapprochera le plus ? Laquelle accomplira ce qu’une traduction devrait idéalement faire, selon moi ?
Mais c’est seulement ce que moi, je pense. Il y a beaucoup de divergences, même entre traducteurs, au sujet des définitions de la traduction. Ma tendance à aspirer à une chose « parfaite » manifestement impossible trahit d’emblée mes propres sentiments sur la relation qu’une traduction devrait entretenir avec le texte original. Et il est certain que lorsque je qualifie mon travail de « traduction », je ne revendique que cette relation. Ma traduction en est une parce qu’elle vise un but inatteignable : être identique à un autre texte. D’une manière générale, plus une traduction est identique au texte de départ, meilleure elle est en tant que telle. Le processus pour arriver à ce nouveau texte est exploratoire, itératif : on part d’un texte et on y revient laborieusement. Et avec un peu de chance, le produit final ressemble à de l’art.
La question à un million de dollars, bien sûr, est « Comment y arriver ? » [Au tarif en vigueur actuellement, il s’agit plutôt de la question à 145 dollars par millier de mots, mais peu importe…](5)